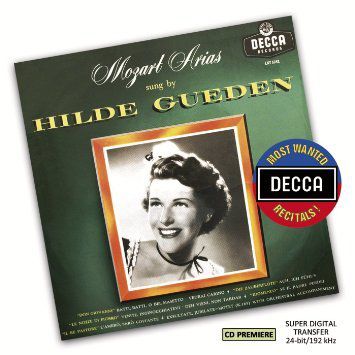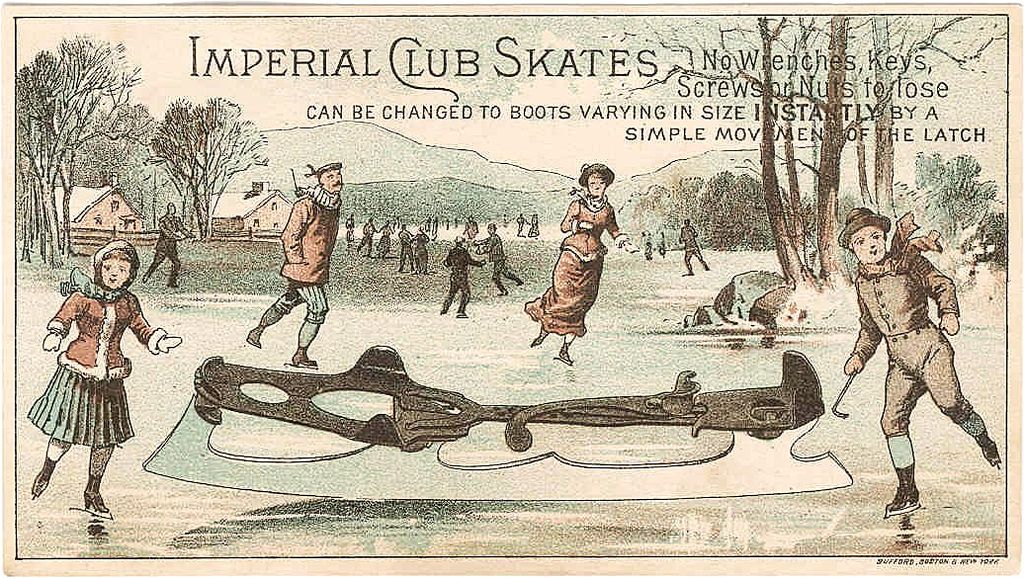1970 eut cela d’exceptionnel que, pour la première et dernière fois de l’histoire (si on excepte évidemment les deux premières années pour des raisons qui coulent de source), toutes les nommées étaient de nouvelles invitées au bal (et trois faisaient quasiment leurs débuts au cinéma). On considère généralement ce cru comme une espèce de nadir dans l’histoire de l’interprétation féminine des USA (vous vous rappelez de 1966 ? Et bien c’est pareil). Pourtant, en y pensant, si on met de côté cette particularité, c’était une année presque banale : on retrouve l’épouse attentive, la jeune fille malade, l’héroïne romantique du film de prestige … les poncifs sont bien au RDV :
- Jane Alexander pour The Great White Hope/L’insurgé (Martin Ritt).
- Glenda Jackson pour Women in love/Love (K.Russell)
- Ali MacGraw pour Love Story (Hiller)
- Sylvia Miles pour La fille de Ryan (D.Lean)
- Carrie Snodgress pour Journal intime d’une femme mariée (Franck Perry … oui … le réalisateur de Maman très chère).
Le nom de Jane Alexander n’évoque pas nécessairement grand-chose aujourd’hui, bien qu’elle travaille encore. Elle fut nommée quatre fois aux oscars, la dernière, pour un rôle principal, pour Testament (1983) mais cela rentre dans une période que je n’ai pas l’intention d’explorer, et bénéficie donc d’une coquette réputation d’actrice dramatique de qualité. J’ai vu L’insurgé sur youtube (dans les conditions que l’on sait) et je l’ai donc découverte dans ce cadre, comme à l’époque la plupart des spectateurs du temps puisqu’il s’agissait, pour ainsi dire, de son premier film. Elle interprète un personnage classique dans la galerie des rôles « à oscar » : celui de l’épouse d’un homme plus célèbre qu’elle, le boxeur Jack Jefferson. L’affaire se corse cependant car Jane Alexander, blanche, joue la compagne du boxeur, noir, au début XXème siècle. Même si le film est un film de boxe, une partie de son intrigue tourne autour de l’union presque impossible entre les deux caractères, qui seront confrontés à toutes les horreurs qu’on peut imaginer et qu’ils tentent de surpasser, en vain finalement (Jefferson passe par la prison et ils finissent par divorcer). Jane Alexander, à part quelques instants fugitifs de bonheur, où elle se montre brutalement lumineuse, interprète Eleanor de manière assez uniformément dépressive. On la devine, on la sait, vaincue par une situation qui la dépasse, depuis le début. La lassitude devient vite sa caractéristique première et c’est surtout cela qu’on retient de sa prestation. Une tristesse douce qui devient parfois désespérée. L’actrice a, néanmoins, assez peu de place où s’exprimer, le métrage des films est essentiellement occupé par les enjeux des combats (je n’y connais rien, mais j’ai cru comprendre qu’il était, pour l’histoire de cette discipline, importants). C’est en fait presque un rôle secondaire qu’on offre à Alexander, mais sa discrétion fait partie du caractère, relativement effacée, du personnage. L’autre dimension frappante dans cette interprétation, à la fois paradoxale et indispensable, c’est une espèce de sensualité, ou pour mieux dire, l’expression d’un désir dévorant pour le personnage de Jefferson. A chaque fois qu’elle le regarde on lit non seulement de l’amour mais aussi quelque chose de presque violent et de pourtant un peu mou, un peu veule, qui va, encore une fois, très bien à ce que l’on comprend du caractère. A son crédit, enfin, l’élégance physique du personnage, qui contraste bien avec l’entourage du boxeur et qui donne, quelque part, encore plus de piquant à leurs relations complexes. Plus j’y pense, plus je crois que c’est une belle interprétation malgré sa relative modestie.

A l’inverse je dois confier ma déception en retrouvant, des années après, Glenda Jackson dans Love (devenu difficile à dénicher avec des stf … je pense qu’un coffret Ken Russell se prépare). Certes le film n’a jamais été …. comment dire … ma tasse de thé (j’ai assez horreur de Lawrence, de toute manière) et j’ai parfois du mal à me retenir de rire (encore que quelques scènes soient vraiment et volontairement drôles). Glenda Jackson, jeune actrice anglaise, dotée d’un charisme monstrueux et d’un mépris absolu pour le cinéma américain (et pour les oscars qu’elle snobait tranquillement malgré ses deux victoires), y faisait, elle aussi, de presque débuts, éclatants et qui éclipsèrent sa partenaire, la malheureuse et aujourd’hui oubliée Jennie Linden (quoiqu’elle soit excellente et qu’elle ait, finalement, un rôle plus démonstratif). Glenda Jackson, malgré un physique qui ne répond pas précisément aux canons de la beauté la plus conventionnel, a cette qualité magique qui fait l’actrice-star et la star-actrice. La capacité, tout en jouant les émotions d’un personnage, de dégager quelque chose qui lui est parfaitement propre. On est toujours intrigué par Glenda Jackson quand elle apparait à l’écran. Sans compter que sa filmographie est d’une grande cohérence et contribue à cette impression de familiarité, relativement fascinante. Evidemment cette donnée n’entrait pas en compte pour le spectateur à l’époque et je me demande si on n’a pas, alors, confondu l’interprétation à proprement parler et le talent naturel de l’actrice à briller devant une caméra (quand bien même elle réciterait l’annuaire). Parce qu’on est captivé par son allure, l’impression d’intelligence (vraiment phénoménale) qu’elle dégage, par son phrasé soutenu et par son timbre grave et j’en passe. Toutes qualités qu’on attribue rapidement à Gudrun, mais qui, en fin de compte, se retrouve d’une création à une autre. En redécouvrant le film je n’ai pas cessé de ne me demander : « mais enfin, qu’est-ce qu’elle veut ? ». Ce qui me dérange, en réalité, c’est que je ne suis pas sûr que l’actrice le sache elle-même. Aime-t-elle sa sœur ? Ses parents ? Son amant ? Contre qui est-elle en colère au fait ? Le scénario n’est pas toujours très clair (j’imagine que le roman ne l’est pas beaucoup plus) mais je me demande si le partie pris de sécheresse, de dureté même, qu’elle affiche, est suffisamment englobant pour recouvrir la richesse du caractère. En écrivant je réalise que ma vision est probablement biaisée. Peut-être qu’au fond la distance ironique, superbement modulée par l’actrice, jamais à cours à ce niveau, est la seule clef qu’on nous offre. Son grand talent, celui de pouvoir exercer autant de puissance au centre d’un registre que je considère comme réduit, est, dans tous les cas à saluer avec un enthousiaste non mesuré. Mais il est vrai, objectivement, qu’il menace toujours de primer sur la sensibilité supposé du personnage et, dans la scène onirique où Jackson danse pour chasser des vaches écossaises (les malheureuses ne demandaient rien), on ne parvient plus du tout à avoir une connexion avec elle, tant cette attitude exaltée (et jouée pourtant en apparence avec beaucoup de sérieux) contraste violemment avec ce qu’elle nous dit de Gudrun pendant le reste du film. Je ne suis pas sorti des abimes de perplexité dans laquelle cette analyse me jette, je crois …
Avec Ali McGraw, c’est beaucoup plus simple. J’ai tout compris, au personnage et à l’interprétation et c’est fort bien joué, mais, évidemment, comme elle est au contraire, d’une simplicité enfantine, on ne peut pas féliciter l’interprète pour la profondeur de sa caractérisation. J’aime bien Love Story. Oui. Je n’ai pas pleuré en le revoyant, mais il y a quelque chose de vraiment « cinéma » dans ce film qui lui donne un charme authentique. Je n’ai vu l’actrice que dans ce film, et pourtant je suis assez content qu’elle ait pu être nommée au moins une fois aux oscars. Après tout elle est parvenue à devenir, à sa manière, légendaire. Elle figurait comme favorite, pour ainsi dire, et remporta le Golden Globe. Il est vrai que mourant à vingt-cinq ans dans un des plus gros cartons de l’histoire du cinéma, cité une dizaine de fois aux oscars cette année là, elle ne risquait pas de rater le coche de la nomination. On ne peut pas vraiment dire, pourtant, que ce soit une distinction amplement méritée. Ali McGraw a posé son personnage lors des deux premières scènes et n’en démordra pas : sa talentueuse musicienne (rappelez-vous : elle aime « Mozart, Bach et les Beatles ») est moqueuse, toujours un peu distante, volontiers allumeuse et prend, autant que possible, systématiquement le rôle « de l’homme » et, plus souvent encore, celui de l’adulte, dans le couple qu’elle forme avec Oliver (rappelez-vous encore : le bel Ryan O’Neal). C’est en effet à Oliver que la charge émotionnelle du film revient. C’est lui qui découvre, progresse, souffre, avance et entame un grand voyage émotionnel vers l’âge adulte. Sa partenaire ne bouge pas : elle est déjà « achevée » quand le film commence. C’est très clair dans le scénario et dans les choix de McGraw, laquelle joue très vite sur le registre d’une ironie assez facile (mais en même temps ça reste une très jeune femme). Ce qui lui manque vraiment ce n’est pas le charme (elle en a vraiment beaucoup) ni la beauté, ni la tendresse, mais plutôt la sensualité. Elle exprime verbalement et à plusieurs reprises son appétit pour son beau compagnon. Jamais ce désir n’est réellement visible à l’écran (voir, pour comparer, Jane Alexander) et cette absence renforce une impression d’artificialité dans la représentation de la maturité dont elle fait étalage. Et si tout cela était du flan ? Jolie question, mais je ne suis pas sûr que l’actrice ait vu aussi loin et si c’est le cas elle est allée bien au-delà des exigences des scénaristes. J’ai l’air sévère. Répétons le charme immédiat de cette interprétation, un peu maladroite peut-être, mais qui dans les moments les plus larmoyants, est quand même diablement efficace. Elle pleure avec quelque chose d’un peu forcé, peut-être, mais pourtant on ne peut pas résister à ce visage humide. Dommage qu’elle n’ait pas pu réellement réaliser sa carrière. Ali McGraw avait incontestablement quelque chose.
Sarah Miles aussi d’ailleurs, qui est probablement, à sa manière, plus satisfaisante et dans l’année qui nous occupe et dans l’ensemble de sa carrière. Contrairement à Ali McGraw elle jouait dans un énorme flop critique et commercial. Mais La fille de Ryan a fini par gagner une aura de respectabilité qui fait défaut à Love Story, aujourd’hui. A l’époque le nom de Lean (qui avait assuré des nominations à plus d’un acteur et plus d’une actrice), le label de prestige britannique qui entourait l’œuvre, suffit à convaincre l’Académie. Le film est fascinant et il le doit d’abord à la réalisation de David Lean, absolument sensationnelle et dont je ne comprends pas qu’elle fasse objet de réserve. Sarah Miles est le visage que le réalisateur exploite. C’est le miroir du film. Dans une interview elle a expliqué récemment que le jeu de John Mills a dérangé réalisateur et producteur. C’est le plus démonstratif du film (et c’est lui qui remporta l’oscar du meilleur second rôle). Au contraire, Miles est au diapason de ses autres partenaires : pudique (Mitchum est, par exemple, particulièrement émouvant dans ce registre). Pourtant, comme beaucoup d’actrices anglaises de sa génération (on pense à Julie Christie) elle a une vulnérabilité et une expressivité à fleur de peau qui exercent une séduction d’autant plus intéressante qu’elle parait naturelle. Je ne pense pourtant pas que l’actrice soit « naturaliste » : avec la relative discrétion que le directeur ou le scénario obtient d’elle, elle est cependant anxieuse de faire montre de ses capacités émotionnelles, c’est visible dans toutes les scènes paroxystiques, quelle soit dans le registre dramatique, dans le capricieux ou dans le sensuel (car, ne l’oublions pas, c’est aussi un rôle formidable). Une trop grande réserve ne serait d’ailleurs pas approprié la « fille de Ryan » est une rêveuse, une exaltée, une fébrile. Cette dimension première Sarah Miles la projette avec une évidence et une facilité, qui, encore aujourd’hui, la font volontiers assimiler à son rôle le plus célèbre. Elle finit par faire absolument corps avec le film et avec le caractère, fait oublier son identité sans s’effacer pourtant totalement derrière le personnage. Bref elle participe avec talent à ce qui fait que La Fille de Ryan est un chef d’œuvre et est devenue, mais avec une justice poétique rare, une forme de personnage culte dans l’histoire du cinéma romanesque, sans être simplement un pantin devant les images du réalisateur. Et je suis assez heureux de cette nomination qui me semble parfaitement justifiée.

Comme l’est sans doute, dans un registre diamétralement opposée, celle de Carrie Snodgress, l’héroïne vaguement antipathique d’un film très difficile à dénicher (vu sur youtube pour ma part … et encore, en morceaux, avec des bouts de bonus rajouté au métrage d’origine) : Journal intime d’une femme mariée. Carrie Snodgress semble avoir, comme Glenda Jackson, snobé la cérémonie et manifesté assez clairement son indifférence à ces futiles questions de prix. Sa carrière, franchement décevante par la suite et qui s’est survécue à elle-même pendant trente ans, de téléfilm en navets horrifiques, n’en a pas été plus brillante et aujourd’hui elle est surtout évoquée que pour ce film, le premier dans lequel elle ait eu un rôle principal. Très principal même. Si ses concurrents partageaient l’affiche, Snodgress se retrouvait pour ainsi toute seule face à la caméra et force est de reconnaitre que cette inconnue était en mesure de dominer son sujet, d’un battement de cil, sans craindre rien ni personne. Elle remporta le Golden Globe, catégorie comédie, passant devant des candidates plus bien plus célèbres, mais elle était alors, on ne le réalise plus en 2013, une espèce de « it girl ». Et puis, je ne l’ai pas encore vraiment dit, son interprétation était incontestablement impressionnante, en plus du métrage qu’elle occupe dans le film. Elle joue une femme au foyer qui s’ennuie et qui n’a pas tout à fait la reconnaissance qu’elle attendrait, à la fois du monde et de son mari. Elle finit par prendre un amant, sans beaucoup plus de succès. L’actrice joue, comme McGraw, sur la distance, mais avec bien plus de finesse et de maturité, puisque l’ironie se projette en priorité sur elle-même. Le personnage n’est pas particulièrement sympathique, mais cet humour sauve absolument Snodgress dont on épouse, à mon avis, systématiquement le point de vue. Elle dégage quelque chose d’intelligent (on pense à Jackson souvent en fait) et d’élégant, sans trop de sophistication, ou alors avec une dose raisonnable de la chose, qui rendent ses scènes toujours riches. En bref, c’est une actrice qui suscite intérêt et curiosité (on se demande vraiment ce qui va arriver au personnage alors que, au fond, il ne lui arrive rien que de très banal) et il est heureux qu’elle ait au moins eu une fois l’occasion de montrer de quel bois elle était faite. Le film s’achève sur une séance de psychanalyse collective où elle se fait lyncher par ses co-analysés. Le dernier plan sur son visage à l’expression légèrement moqueuse, incrédule, à la fois coupable et légèrement supérieure, achève de persuader le spectateur de l’aisance de cette caractérisation et est un très bel hommage du réalisateur au talent de son interprète principale.
Elle remporta un Golden Globe, devant Barbra Streisand (pas mauvaise du tout en prostituée intello dans La Chouette et le Pussycat), Julie Andrews (merveilleusement filmée par Blake Edwards dans Darling Lili), Sandy Dennis dans The Out of the Town (elle y faisait du Sandy Dennis dans un registre comique) et Angela Lansbury (cette dernière allumée à souhait dans ce chef d’œuvre d’humour noir qu’est Something for everyone, un film indispensable dans son genre). De son côté Ali McGraw triomphait de Jackson, Miles mais aussi Mercouri (dans une adaptation que je n’ai pas vue des Promesses de l’aube) et surtout de Faye Dunaway, sublime, le mot est faible, dans Portrait d’une enfant déchue, très franchement un triomphe interprétatif, très différent de ce que l’actrice a pu offrir ici et là. Le film fut massacré par la critique à sa sortie, preuve de l’aveuglement de certains, ce qui couta sans doute une nomination bien méritée à l’actrice, vraiment bouleversante. Elle aurait été ma gagnante, en assez bonne compagnie. Je n’ai pas vu Butch Cassidy et le Kid, Bafta pour Katherine Ross. Pour les autres prix c’est en général Jackson qui a raflé la mise.
- Faye Dunaway pour Portrait d’une enfant déchue (Schatzberg)
- Angela Lansbury pour Something for everyone (Harold Prince)
- Genevieve Page pour La vie privée de Sherlock Holmes d’on sait qui (presque un second rôle, mais je garde un souvenir extrêmement émue de cette interprétation d’une élégance irréelle.)
- Carrie Snodgress pour Journal intime d’une femme mariée
- Raquel Welch pour Myra Breckinridge (Ouais. Et j’assume en plus. Elle me fait hurler de rire du début à la fin, et ce n’est pas parce qu’elle est mauvaise).

Pour information : je poursuis jusqu'en 1973, en alternant avec des articles musicaux, as usual. Fermeture temporaire ensuite.